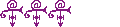Le film Happy Feet débute en plein milieu du cosmos, sur les paroles de la chanson des Beatles, Golden Slumbers : “Once there was a way to get back homeward... Once there was a way to get back home.” (Autrefois existait un chemin du retour… Autrefois existait un chemin pour retourner au foyer.) La caméra plonge au cœur de la Voie lactée et passe au-dessus du Soleil, sur lequel vient s’inscrire en relief le titre du film. Puis nous nous dirigeons enfin vers cette petite boule bleue qu’est notre Terre, et plongeons dans la banquise où va débuter notre histoire.
Ce qu’il y a de pratique avec les cinéastes érudits et précis tels que George Miller, c’est qu’en quelques secondes seulement, leur note d’intention sonne comme la plus prometteuse des invitations et ouvre en grand l’étendue de leur ambition. A l’inverse, ce qu’il y a de terrible avec un film tel que Happy Feet, c’est que sa limpidité, sa simplicité et sa facilité d’approche interdisent presque d’évoquer ce qu’il représente vraiment. Comment, en effet, expliquer qu’un dessin animé rigolo, avec des pingouins qui font des claquettes sur la banquise, s’avère l’un des films les plus brillamment intelligents à nous être parvenus cette année, toute catégorie confondue ; et ceci sans passer pour un critique farceur qui aurait un peu abusé du punch coco ?
Pourtant les faits sont là, inscrits en toute lettre, à la fois dans la structure du récit et dans sa mise en scène. Le récit tout d’abord, qui s’inscrit dans la tradition immortelle (mais si souvent assassinée !) de la quête initiatique : parce que l’œuf où il reposait a été violemment secoué durant sa gestation, le héros Mumble naît « anormal », marqué par sa différence au sein du groupe, incapable de s’intégrer à la structure existante. Il est d’emblée condamné par la Providence à suivre ce que la mythologie comparée appelle « la Voie de gauche », c’est-à-dire une quête initiatique individuelle qui le mènera à modifier la structure du groupe tout entier, à le faire évoluer vers un stade plus avancé que « l’anormalité » du héros annonçait (rappelons que George Miller est l’auteur d’une des préfaces à l’ouvrage de Joseph Campbell "Les Héros sont éternels", livre de référence de la mythologie comparée).

Le cinéaste connaît parfaitement les résonances et les abysses de complexité qui se trament derrière cette structure ancestrale du récit, et sait dès lors en quoi chaque rencontre, chaque nouveau personnage mis sur le chemin du héros, contribuera à ébranler ses quelques certitudes. Ces rencontres s’échelonnent avec une intensité graduelle, à la fois au niveau de l’étrangeté des comportements et, visuellement, dans le poids des animaux rencontrés. Elles débutent par un groupe d’oiseaux aux accents maffieux (évoquant leur rôle déterminé, et donc compréhensible, dans ce type de société) pour culminer dans une attaque d’orques aux motivations totalement mystérieuses. George Miller se permet entre-temps de conclure une séquence typique de poursuite (un énorme otarie poursuit le héros) par un retournement de situation qui devient de façon évidente un retournement de valeur, à la fois hilarant et étrangement gênant.
Et la plongée pour son héros au cœur du danger et de l’inconnu ira jusqu’à son point limite, lorsque tous les murs de la certitude auront été abattus et laisseront enfin apparaître le mur d’une « réalité » entièrement factice, dernière barrière à franchir, dernier péril des âmes, où l’identité doit se dissoudre pour enfin renaître. Film pour enfants certes, mais certainement pas film infantile, Happy Feet n’hésite pas, à cet instant-clé, à faire descendre son public au fond du puits, dans une séquence d’aliénation mentale qui n’a presque rien à envier à un Midnight Express autrefois interdit aux mineurs (au passage, un script écrit par Oliver Stone, et partiellement basé sur la structure du livre cité plus haut). Et l’analogie visuelle et sonore qu’emploie alors George Miller pour suggérer cette renaissance (reprise à l’identique de la scène de naissance en début de métrage) est véritablement ce que l’on peut appeler de la pure poésie cinématographique !

Car la mise en scène, bien évidemment, s’est hissée à la hauteur de son sujet. Malgré sa thématique, Happy Feet n’a pas vocation à marcher sur les traces ouvertement ésotériques d’un Jodorowsky. Film grand public, au sens le plus noble du terme, il a vocation à d’abord faire ressentir son sujet, sans même forcément transiter par le filtre intellectuel. En conséquence, les scènes de chant et de danse, essentielles à l’intrigue parce qu’essentielles au sens de l’œuvre, ont bénéficié d’un soin chorégraphique maniaque. Parce qu’il s’agit la plupart du temps de détailler la place d’un individu au sein du groupe, la mise en scène de George Miller doit ici, par la force des choses, user de plans beaucoup plus longs que ceux auxquels l’animation de ces dernières années nous a habitué. Le cinéaste compense donc la longueur de ces plans par la vivacité d’une caméra ultra-mobile, et ne s’autorise un découpage spasmodique que dans les rides et les poursuites de malade qui émaillent son aventure, où soudain la brièveté des plans pousse presque jusqu’à la limite de la persistance rétinienne. On avait presque failli oublier que ce type a réalisé certaines des plus belles poursuites de l’histoire du Cinéma.
Le seul bémol à apposer à l’entreprise artistique tient à sa durée. Malgré ses 108 minutes, Happy Feet semble parfois manquer de temps pour déployer pleinement son projet. D’un rythme le plus souvent soutenu, le film se voit obligé, surtout sur sa dernière bobine, à user de quelques ellipses brutales pour parvenir plus rapidement à sa conclusion. On commençait à prendre l’habitude de se plaindre de films épiques trop longs, nous voilà aujourd’hui à regretter un film d’animation trop court…

D’aucuns s’étaient a priori demandés ce qui pouvait pousser un grand cinéaste à se consacrer aussi longtemps (plus de quatre ans de développement) à un dessin animé enfantin, surtout lorsqu’il a à son actif un film classé X en France (le premier Mad Max), une comédie sophistiquée sur la guerre des sexes (Les Sorcières d’Eastwick) ou un drame médical d’une violence insoutenable (Lorenzo). Réponse de l’intéressé : « L’histoire est reine ! Ce qui me passionne dans le cinéma, c’est d’explorer les univers les plus variés en essayant toujours de trouver les histoires les plus riches de sens. Je ne vois pas de différence fondamentale entre, disons, Mad Max et des fables animalières telles que Babe ou Happy Feet. » Et ces propos sont d’autant plus honnêtes qu’on remarque effectivement de fortes similitudes entre Happy Feet et le film Mad Max 3. On y retrouve le monde cultuel et hiérarchisé replié sur ses rituels (le Thunderdome – les manchots empereurs), on y retrouve le maître de cérémonie déchu, qui habillait sa souffrance d’une aura mystique (le nain « The Master » - le gourou Lovelace), on y retrouve le groupe des « petits » qui eux seuls peuvent mener à l’antique ville des hommes (la tribu d’enfants – la tribu des pingouins). En 1985, la pression financière n’avait semble-t-il pas permis à Miller d’exploiter l’étendue des thèmes qu’il cherchait à aborder. C’est donc une surprise de voir comment Happy Feet semble répondre, à vingt ans d’intervalle, au relatif échec artistique que fut Mad Max 3, qui se voulait, en conclusion de la saga, le film de l’espoir et du retour aux sources.
En effet, l’aventure de Mumble ne consiste pas à mener son enquête pour retourner simplement vers son foyer de la banquise, elle consiste à trouver la Voie par laquelle tous ses semblables manchots, aliénés par la souffrance, obsédés par la lutte pour la survie, s’ouvriront à l’énergie de la source et remonteront d’un cran vers leur « paradis » originel. Et comme les humains l’ont semble-t-il compris un jour (avant de presque l’oublier) cette ouverture à l’énergie de la source se pratique par le rituel du chant et surtout celui de la danse, en harmonie avec les forces spirituelles de la compassion et de l’amour.

Attention pourtant ! Il ne s’agit pas de céder ici à un certain conformisme religieux ou à la béatitude new-age, et George Miller n’hésite d’ailleurs pas à égratigner certains cultes de la peur et de la soumission à travers des personnages de patriarches affreusement superstitieux. Il s’agit pour lui, plus posément, de soulever la question spirituelle des origines à travers le scepticisme raisonnable d’un savant tel que Carl Sagan, quelque chose qui voguerait entre ce que la raison nous a fait découvrir de l’univers et de ses probabilités, et ce que certains mythes fondamentaux nous ont induit quant à notre rapport à lui (rappelons au passage que c’est George Miller qui a développé sur plusieurs années le projet d’adaptation du roman de Carl Sagan Contact, avant d’être remplacé en dernière minute par Robert Zemeckis… qui a semble-t-il conservé certaines de ses idées).
Ainsi, le happy end de ce Happy Feet apparaîtra en premier lieu comme une forme de discours écologique adapté aux préoccupations contemporaines, ce qu’il est partiellement. Mais au-delà de l’actualité du siècle, George Miller rappelle quelque ancienne sagesse qui devrait calmer nos ardeurs catastrophistes. Car même si notre petite banquise ronde et bleue, perdue au fin fond de l’univers, semble menacée dans son équilibre, ce ne sont pas la peur et la superstition qui nous sauveront. Seuls le chant et la danse (et ce qu’ils signifient profondément pour les âmes qui s’y abandonnent) sauront nous faire retrouver un jour « le chemin du retour au foyer ». Pas étonnant donc que Prince se soit fendu d'un titre final pour le film après avoir été sérieusement rétif à l'idée qu'on puisse utiliser ses titres ("Kiss" chanté en ouverture par Nicole Kidman et Hugh Jackman).

Alors que défile son générique de fin sur fond d’étoile, Happy Feet confirme donc, comme nous l’annonçait son générique de début, qu’il est un film véritablement universel ; ce dernier mot étant à prendre au sens le plus strict.